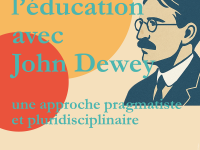Journée d'étude(s) "Penser l'éducation avec John Dewey", le - Campus Saint-Germain-des-Prés, Salle Margaret Maruani, organisée par le Centre de recherche sur les médiations, Université de Lorraine et le Cerlis, Centre de recherche sur les liens sociaux, Université Paris Cité, Université Sorbonne Nouvelle, CNRS.
John Dewey, figure majeure du pragmatisme, a laissé une œuvre de plus de quarante ouvrages qui a durablement influencé de nombreux champs scientifiques aux États-Unis et à l’international. Sa pensée holistique conçoit l’expérience humaine comme un tout intégré où pensée, émotion, action et environnement sont indissociables. Parmi ses nombreux centres d’intérêt, l’éducation occupe une place centrale : Dewey la conçoit non pas comme un simple domaine ni comme un outil au service d’objectifs extérieurs, mais comme l’« expérience première » : une pensée réfléchie engageant des individus dans un environnement qu’ils transforment et qui les transforme. Il valorise une pédagogie fondée sur la participation, le questionnement, le doute constructif et la coopération, rompant ainsi avec la simple transmission passive des savoirs. Cette approche alimente aujourd’hui les réflexions sur l’esprit critique, ainsi que sur l’éducation aux médias et à l’information, indispensables face aux risques informationnels et aux enjeux démocratiques actuels. Par ailleurs, une filiation implicite peut être établie entre Dewey et la seconde philosophie de Wittgenstein, qui a tiré profit de sa lecture d’Expérience et Nature. Comme Dewey, Wittgenstein, ancien instituteur, s’appuyait sur l’observation des élèves pour montrer que parler, c’est expérimenter et agir sur le monde. Bien que principalement reconnu comme philosophe du langage, Wittgenstein partage avec Dewey la conviction que l’apprentissage s’inscrit dans les pratiques sociales et langagières en contexte. Leur conception commune des liens entre éducation et communication éclaire l’expérience éducative comme un processus actif et contextuel. Cette journée invite donc à mobiliser une approche pluridisciplinaire pour mieux comprendre comment langage, pratiques informationnelles et dispositifs éducatifs interagissent dans les phénomènes éducatifs. En effet, la portée transversale de la question éducative semble favoriser un dialogue entre sciences du langage, sciences de l’information et de la communication, et sciences de l’éducation et de la formation.
Programme
09H00 - Accueil des participant·es
09H30 - Ouverture de la journée par Anne Barrère, Université Paris Cité, Cerlis, Bérengère Stassin, Université de Lorraine, Crem, et Annabelle Cara, Université Paris Cité, Cerlis-EDA
Session 1. La place de l’expérience et de l’enquête en éducation
Modération : Céline Robillard, EDA, Université Paris Cité
10H00 - Les expériences en éducation, l’éducation comme expérience
Renaud Hétier, Université Catholique de l’Ouest, Lirfe
La notion d’expérience nous paraît jouer un rôle clé dans le pragmatisme, et notamment à travers la fonction opératoire que lui attribue John Dewey. Elle est transversale à différents niveaux : constitutive de la vie elle-même et du progrès par l’adaptation de tout organisme, elle n’est pas moins nécessaire au travail culturel proprement humain, notamment celui de l’enquête, qui doit permettre l’édification d’une logique. C’est enfin, on s’en doute, une notion à la fois riche et ambiguë en éducation : toute l’éducation est-elle en soi une expérience continue et synthétique, ou bien organisation d’expériences plus ou moins réglées, allant de l’expérience vécue à celle de laboratoire, ou encore alternance d’expériences et de ruptures ? »
11H00 - L’éducation démocratique comme apprentissage de l’enquête
Anne Lehmans, Université de Bordeaux, IMS
John Dewey propose une vision de l’éducation comme une expérience partagée, communicable et communiquée, qui repose sur la méthode de l’enquête. Celle-ci consiste à interroger l’environnement social et culturel et à chercher des solutions aux situations d’incertitude par l’exploration : l’élève est avant tout un enquêteur avec l’enseignant, et la démarche d’enquête reste la condition de sa construction comme citoyen participant à la vie démocratique. Cette conception est particulièrement intéressante à revisiter à l’heure des injonctions au développement de l’esprit critique, dans un contexte politique et technologique qui met à l’épreuve la science, la démocratie et l’éducation.
12H00 - Déjeuner
Session 2. Apports et limites de la pensée deweyenne
Modération : Arthur Ancelin, CUniversité Paris Cité, Cerlis
13H30 - (Re)lire L’école et la société : Un laboratoire de la philosophie de l’éducation deweyenne
Samuel Renier, Université de Tours, Éducation, Éthique et Santé
Publié en 1899 aux Etats-Unis, et constamment réédité depuis, The School and Society a connu une réception comparativement discrète en France, où aucune traduction intégrale n’avait été réalisée jusqu’à présent. Cet ouvrage occupe pourtant une place singulière dans l’œuvre du philosophe pragmatiste américain John Dewey, dans la mesure où il s’agit de son premier livre dédié aux questions éducatives, se démarquant ainsi de ses premiers écrits consacrés à l’histoire de la philosophie ou à la psychologie. Cette place singulière s’explique également par la relation étroite qui se tisse entre la constitution de la réflexion deweyenne sur l’éducation et l’expérimentation qu’il conduit alors à l’Université de Chicago, à travers la création d’une « école-laboratoire ». Si l’idée de laboratoire cherche à traduire la place importante laissée à l’expérience et à l’expérimentation, il est possible de voir dans ces réflexions sur l’éducation un laboratoire de la philosophie pragmatiste alors en voie de construction, où se retrouvent déjà les grands thèmes de la pensée deweyenne.
14H30 - Au-delà de la rhétorique : analyse de quelques impensés deweyens en matière sociale et raciale au prisme des pratiques pédagogiques progressistes.
Sébastien-Akira Alix, Université Paris-Est Créteil, Lirtes
Dans le sillage des travaux d’historiens de l’éducation comme Larry Cuban et Michael Knoll, la présente communication propose d’appréhender, « au-delà de la rhétorique », les idées éducatives de John Dewey dans leur contexte, notamment à partir de l’examen des pratiques pédagogiques conduites dans son École Laboratoire de l’Université de Chicago (1896-1904) et de l’étude des pratiques d’enseignement progressistes valorisées par le philosophe dans son œuvre. Sur cette base, cette communication met en lumière les décalages entre les discours et les idées pédagogiques du philosophe et les procédés discursifs et les pratiques scolaires qu’il mobilise et valorise par ailleurs dans son œuvre. Ce faisant, cette communication entend replacer l’œuvre pédagogique du philosophe dans son contexte de conceptualisation et éclairer certains impensés pédagogiques deweyens, notamment en matière sociale et raciale.
15H30 - Bilan de la journée et perspectives
251201-john-dewey-programme Barrere Anne
contact et inscription : annabellecara@hotmail.com berengere.stassin@univ-lorraine.fr